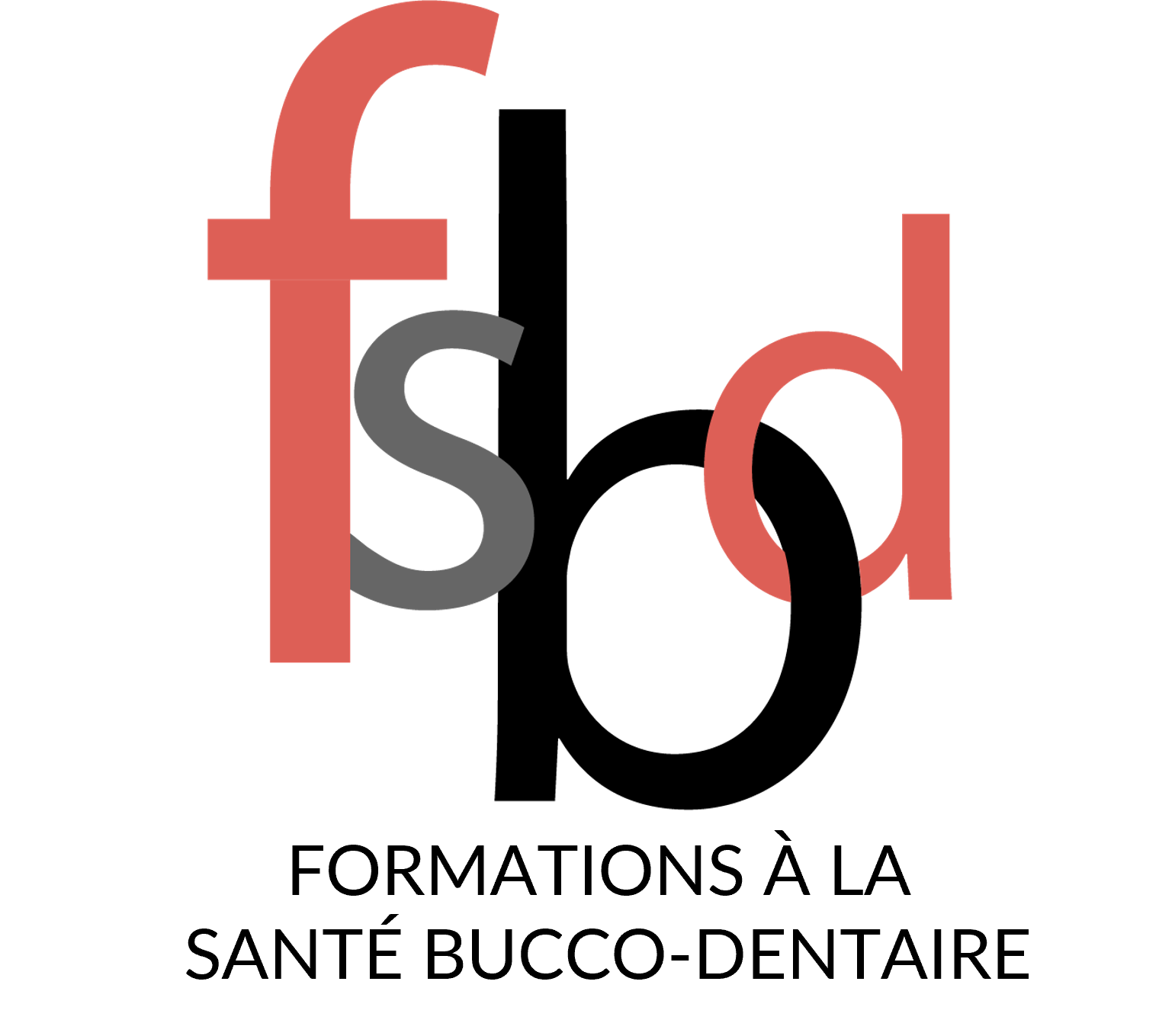Chez la personne âgée dépendante ou polypathologique, le raisonnement thérapeutique ne peut être calqué sur celui appliqué à un patient jeune ou autonome.
L’état général, les traitements en cours, les troubles cognitifs, les difficultés de déglutition, la fatigabilité ou encore le risque de refus imposent au praticien d’adopter une démarche fondée sur le juste soin.
Le juste soin, c’est celui qui trouve le point d’équilibre entre le bénéfice attendu, la tolérance du résident et sa qualité de vie.
Il s’agit moins de rechercher l’idéal technique que de déterminer ce qui est cliniquement pertinent, acceptable et proportionné pour la personne concernée.
C’est une approche de proportionnalité thérapeutique, inspirée des principes éthiques de la gériatrie : ne pas renoncer aux soins, mais ne pas imposer des actes disproportionnés au regard de l’état général et du pronostic.
Ainsi, dans certaines situations, la priorité ne sera pas la restauration fonctionnelle complète, mais la suppression de la douleur, la prévention infectieuse ou le maintien d’un confort masticatoire minimal.
Ce « juste soin » suppose une évaluation clinique globale, intégrant les contraintes médicales, psychiques et sociales, mais aussi la possibilité d’assurer un suivi réaliste (hygiène quotidienne, contrôle, ajustement des prothèses…).
La mise en œuvre de ce principe repose sur une concertation interdisciplinaire : le dentiste ne décide pas seul, mais en dialogue avec le médecin coordinateur, le personnel infirmier, la famille et, si possible, le résident lui-même.
Dans le cadre de la télé-expertise, le « juste soin » consiste aussi à guider le personnel sur la conduite à tenir (surveillance, soins palliatifs, soins différés ou prioritaires) en tenant compte du contexte global.
Le « juste soin », en odontologie gériatrique, n’est pas un soin minimaliste : c’est un soin ajusté, raisonné et humaniste, où la qualité de vie prévaut sur la seule correction des lésions.